Colloque « Philosophie, anthropologie, émancipation : autour de Lucien Sève ». Organisé par la Fondation Gabriel Péri ; ENS & Sorbonne, 9 et 10 décembre 2016
[2016] Yves Schwartz. Activité et personnalité : un débat avec Lucien Sève ; Colloque "Philosophie, anthropologie, émancipation : autour de Lucien Sève", Sorbonne-ENS, 9 et 10 décembre 2016, vidéo, durée 37:00
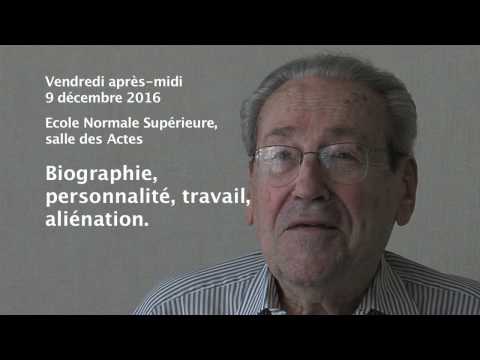
Transcription
Colloque : « Philosophie, anthropologie, émancipation : autour de Lucien Sève » Sorbonne-ENS, 9-10 décembre 2016.Communication de Yves Schwartz :« Activité et Personnalité : un débat avec Lucien Sève »*Je commencerai par évoquer la place de Lucien Sève dans mon itinérairebiographique, ma rencontre avec lui, et ce que j'ai fait de cette rencontre.Ma rencontre n'a pas eu lieu dans ma formation classique d'apprentiphilosophe, dans ce que j'ai appelé le « chaudron » de l'ENS Ulm des années60 ; chaudron en raison du bouillonnement d'idées et d'événements qu'ellehébergeait et à la surface duquel tous ceux qui pensaient y avoir acquis desconvictions et des certitudes pouvaient surnager et jouir du temps.L.Sève a souvent parlé de ses rapports avec L.Althusser, gouvernantinstitutionnellement et par son immense prestige les enseignements dephilosophie à l'ENS. Mais revenant sur ce point dans Pour une science de labiographie (2015), il dit encore plus explicitement que pour E.Balibar et lecercle des sectateurs, Marxisme et Théorie de la Personnalité (MTP) était un« non livre » (p.37). Quelle que soit l'estime admirative que je conserve,« malgré tout », pour mes anciens condisciples et notre « caïman »(nom donné à l'ENS au Directeur des Études de chaque discipline.), je suisencore ulcéré de ce sectarisme dogmatique, et je mesure souvent quellegrandeur d'âme il a fallu à Lucien pour supporter cette stratégied'« inexistence » que je connais bien. Et c'est chaque fois sans agressivitéqu'il évoque cette injustice intellectuelle.Comment donc s'est opérée cette rencontre ?De mes années de formation, j'avais éprouvé un profond malaise, face à ceque je ressentais comme une distance indéfiniment réactualisée entre leslieux de l'usinage intellectuel et le monde quotidien des activités industrieuses.Pour traiter ce malaise, ma thérapeutique à partir des années 70 s'estdéployée selon un double registre :- mieux apprécier la logique de fabrication des concepts en m'affrontant à desproblèmes d'histoire des sciences, d'histoire des techniques puis d'histoiredu travail (au XIXème siècle, surtout). Pour plusieurs raisons, ce n'est pasdans cet itinéraire que je pouvais rencontrer l'œuvre de L.Sève.- mieux apprécier ces ressources invisibilisées du monde du travail, via uneactivité militante comme responsable universitaire formation continue,comme dirigeant syndical, puis politiquement missionné pour faire avancerdes horizons démocratiquement transformateurs dans le domaine del'alternance éducative et plus généralement dans les relations Ecole-Travail.En cette période, fin des années 60, début des années 80, cette doubleexpérience de « visiteur du travail » a fécondé en moi une série de réflexionsme libérant progressivement de la lourde ambivalence accrochée en moi parmon passage dans le « chaudron ». Je dis souvent qu'il m'a fallu au moins dixans pour faire 100 mètres, les 100 mètres séparant le 45 de la rue d'Ulm du 41rue Gay-Lussac, au laboratoire d'ergonomie du CNAM d'Alain Wisner et deJ.Duraffourg, où le regard à la loupe sur l'activité de travail devaitprogressivement contribuer à la construction d'une anthropologie que riendans l'héritage althussérien ne pouvait autoriser.C'est en cette même période que j'ai lu MTP. L.Sève évoque souvent, avec sagénérosité, les quelques critiques que j'ai pu ultérieurement faire à cetouvrage. Mais pour un néophyte « visiteur du travail », luttant pour que l'ondonne visibilité à un « sujet » aux prises avec un « drame » dans le travailsalarié, enjeu jusque là à peu près ignoré, ce que j'appellerai un peu plus tard« usage de soi par soi », MTP apparaissait comme un monument de bon sens,un gouffre de vérité. Etait enfin légitimé de s'interroger sur l'activité de travailcomme lieu où les dimensions globales du monde social s'invitaient dansl'agir productif quotidien.Ma dette à l'égard de MTP n'est donc pas de peu d'importance. Comme unesorte de libération philosophique. Et c'est à partir de là que j'ai commencé àprendre connaissance d'une œuvre considérable, d'une éruditionprodigieuse, particulièrement marxienne (VoirUne Introduction à la Philosophie Marxiste), et d'une exigence impressionnante d'auto-interpellation par tous les apports intellectuels susceptibles d'interférer avecses thèses. "L'homme" ? (2008) est un extraordinaire exemple.Au delà de cette lecture, il y eut pour moi trois moments décisifs dans larencontre que j'ai eu le bonheur d'avoir avec lui :-comme directeur des Editions Sociales, il a favorisé la publication deL'homme Producteur, autour des mutations du travail et des savoirs (1985),où avec D.Faïta, nous tentions d'évoquer cette première expérience de travailsur le travail avec les travailleurs, nourrie et comme exigée par cetteexpérience de « visiteur du travail ». Noyau initial d'une dynamique formativeet d'interrogation anthropologique aujourd'hui plus que trentenaire,totalement innovante dans l'université, et matrice de collaborationsnationales et internationales.Contractant avec moi pour la fabrication d'un ouvrage militant synthétisantles acquis de ces « visites du travail », il a parfaitement accepté et encouragéla progressive transformation de ce projet en une thèse d'Etat,Expérience et Connaissance du Travail, soutenue en 1986 et qui heureusement devaitrevenir aux Editions Sociales pour publication en 1988, même s'il n'en étaitplus directeur.Enfin, en cette période intellectuellement et politiquement si féconde, s'estdéveloppé à l'IRM sous son autorité ce séminaire sur la question du statut del'individualité dans le marxisme, dont le résultat final devait êtreJe, sur l'individualité, en 1987. Chacun a pu mesurer dans ce projet collectif qui a faitbouger les choses cette capacité du personnage à écouter, cette si raredisponibilité à se remettre en question si nécessaire, ses exceptionnellesqualités de générosité intellectuelle couplées à des convictionsémancipatrices jamais prises en défaut.Puisqu'il est en question l'anthropologie dans ce colloque d'hommage, jesouhaiterais éclairer brièvement un point clé pour lui comme pour moi, nosconvergences et nos divergences autour du concept d'activité.1- La Tätigkeit, « activité », de l'idéalisme allemand retravaillée par Marx puisredisposée par la psychologie soviétique notamment Léontiev (voir nos textesde 2001, 2007, 2015 a) est au cœur de l'anthropologie sévienne ; de mêmeque ce concept est l'épine dorsale de notre « Démarche Ergologique », ou« étude de l'activité ». Point de convergence majeur entre nous. « On mesureici combien est décisive la pensée du psychisme humain commeactivité » (L'Homme, note 447, p.401). Voir aussi ibid p.484, « l'activité, la Tätigkeit »,« mode cardinal de l'être homme », également, MTP, p.46, 47, 145. Conceptqui est aussi la matière de notre débat des années 80-85, sur lequel il estrevenu souvent avec son habituelle magnanimité.Mais, entre MTP et ses ouvrages ultérieurs, au delà de son souci d'atténuer ladisjonction entre activités abstraites et concrètes, effet des remarquescritiques des « visiteurs du travail » comme I.Oddone et moi-même, c'est bienautour du contenu de ce concept d'activité que vont se jouer des élaborationsanthropologiques différentes.2- On connaît la puissance du dispositif fondateur par lequel L. Sève, héritantdes anticipations marxiennes, va penser les dramatiques biographiques : la6ème Thèse sur Feuerbach posant l'excentration de l'essence humaine, horsde chaque individu singulier, pose la question des formes d'appropriation(Aneignung) disponibles pour chaque être humain, à chaque moment del'histoire, de cette essence excentrée. Question renvoyant à celle de sesformes d'activité (Tätigkeit) -dimension cardinale de l'être homme- : dans son« emploi du temps », quels segments de son temps de vie l'articulentproductivement sur cette essence excentrée ? Les Formes d'Individualitépropres aux formations sociales capitalistes majorent de façon écrasante lestemps dominés par des activités « abstraites », activités où n'est socialementpertinente dans leur agir que le travail abstrait, au sens de Marx, celles qui leséparent des puissances et pouvoirs qui actualisent le patrimoine del'essence humaine, devenu réservoir de fremde Mächte, puissancesétrangères (Voir Aliénation et Emancipation , pp.27, 56-57...)En un sens « gouffre de vérité » avons nous dit. Et pourtant comme visiteur dutravail sans avoir jamais abandonné nos adhérences philosophiques (au faitpourquoi L. Sève me désigne parfois comme sociologue et plus récemmentcomme psychologue du travail ?), j'ai dû progressivement réélaborer unconcept d'activité, beaucoup moins médiateur (entre l'essence humaine etl'individu) que producteur d'une histoire humaine, s'inscrivant, mais selonune énigmatique discontinuité, dans l'histoire de la vie.3- Pour moi, l'universel débordement du travail prescrit par le travail réel, oubeaucoup plus généralement, des normes antécédentes par lesrenormalisations, m'ont renvoyé à la question canguilhémienne du « Qu'est-que vivre ? » (conforté par l'apport de mes deux autres « médecinsatypiques », I.Odone et A.Wisner2). Bien qu'aucun des deux ne m'en ait jamaisparlé, je sais que les relations entre G.Canguilhem et L.Sève n'ont pas été unchemin de roses. Pour autant, je n'ai jamais cessé de dire ce que je dois àchacun. En l'occurrence, plutôt que de définir la spécificité anthropologique àla manière de la 6ème Thèse, je la repérerais comme le fait pour toutepopulation humaine de vivre dans un milieu de normes (normes antécédentesles plus diverses, mais d'abord orientées sur le comment produire etreproduire la vie sociale).L'activité apparaît donc comme une « transformée » de la vie, vivre dans unmilieu de normes, mais qui intègre en elle, comme prolongation de la vie, sonexigence transversale : tenter de « vivre en santé » ; ce qui veut dire vivredans un milieu polarisé en valeurs négatives ou positives par rapport à cetteexigence de santé. Valeurs qui dès les premiers groupes humains serontmédiatisées par les normes saturant ces milieux et propres à chacun de cesgroupes. Par là, le « qu'est-ce que vivre ? » pour chaque humain sera toujoursun enchaînement de débats, plus ou moins polémiques, avec les normes deson milieu.4- En quel sens l'activité ainsi entendue est en permanence productrice etreproductrice d'un monde ?Avant d'être Aneignung ou appropriation d'une essence excentrée, l'activitéest donc absorbée par le traitement ici et maintenant d'une triple infidélité :l'infidélité d'un milieu instandardisable quelque normé qu'il puisse être et endépit des efforts de tous les gouvernements à l'autorité (voir l'O.S.T, legouvernement taylorien du travail). Et par rapport à ce milieu, l'infidélité detout agir humain, dont l'exigence de santé porte un pouvoir positif de prise dedistance à l'égard de ce qui dans les normes qui le saturent, menace cetteexigence. Et infidélité de lui-même par rapport à lui-même dès lors que lasédimentation en lui des traitements de cette double infidélité, où le convoquechaque moment de sa vie, ne cesse de transformer ce soi énigmatique quidoit faire face aux situations à vivre. Et donc ce soi ne sait jamais exactementce qu'il est devenu, en termes de ressources et de limites, quand il lui fautrépondre à ces convocations. Autrement comme déjà fréquemment dit,instruit par la fréquentation des situations de travail, cette triple infidélitésignifie qu'il est impossible et invivable pour tout agir humain d'être un purexécutant des normes antécédentes. Dans cette transformée de la vie -l' « activité » - qui tente de vivre en santé dans un monde de normes, dans satentative d'exercer ici et maintenant son « libre jeu des facultés » (pourreprendre un terme kantien), on tient là à mon avis ce qui « fait histoire », cequi produit de l'histoire. J'ai l'impression que cette activité, en ce sensnativement « productive », remplit une absence dans les rapportsbiographie / personnalité chez L.Sève : sans elle, quel moteur génère « ce qu'un individufait ou non de sa vie » face à ce que la vie fait de lui (L'Homme, p.514) ?Trois grands personnages, qui ont tous fait des études de médecine, mais dont lacontribution à la réélaboration d'un concept largement démédicalisé de santé, au-delàde toute pratique médicale stricte, nous a dotés de perspectives majeures pour penserl'action transformatrice sur le monde social.Comment « se tricote » le système de valeurs où se construit la personnalité(ibid, p.484), le va-et-vient entre biographie et personnalité, sinon mû parcette exigence de vivre en santé le présent ?C'est à ce débat polémique à revivre en permanence au présent que nousastreint l'activité : ni savoirs, ni valeurs, ni construction de « l'essencehumaine » ne peuvent passer au dessus des épaules de ce faire histoire mûpar les dramatiques de l'activité.5- « Ni savoirs » venons-nous de dire.Logiquement, l'aliénation telle que la retravaille, non sans raison L.Sève, est« spirituelle », une « frustration des possibles, ceux du développementintellectuel, de la large compréhension du monde et par là même du pleinpouvoir d'agir en citoyen » (L'Aliénation, pp.34-35). On peut se demanderqui pourrait échapper totalement à la frustration, et si les nouveaux contours dutravail ne reposent pas la question. Mais là n'est pas le point : qui dit activitédit retravail des normes, « renormalisation ». Et va-t-on renormaliser quelquesituation sans des halos de savoir qui motivent cette renormalisationet doit instant après instant réévaluer à quelles conditions elle peut vivre. Cessavoirs de la réévaluation ne peuvent se limiter aux savoirs « militants »,même « engagés », selon la modification assumée dans L'Homme (p.511).Donc « frustration », sans doute, mais un continent de savoirs techniques,relationnels, ambiantaux, culturels, ayant un rapport inassignable à la mise enlangage, diversement socialisés, accompagne tout agir, (industrieux ouautre) ; continent de savoirs auxquels doivent être confrontés, pour quicherche à connaître une situation sociale, les savoirs formels, révélés par làmême pour une part lacunaires.Toute ambition de connaissance portant sur de l'humain doit donc s'instruirede l'activité dans ses œuvres. Avec cette réémergence de la « communautéscientifique élargie » d'Oddone, avec son retravail ergologique sous la forme« dispositifs dynamiques à trois pôles », intégrés comme conséquence du« faire histoire de l'activité », se retrouve ici le second lieu de débat récurrentavec Lucien, la question de la science du singulier. Ce serait là que nos deuxépistémologies divergent : qu'il y ait une science du singulier possible là où iln' y a pas d'activité au sens précédemment défini, comme pour la cosmologieou l'évolution (voir S.J Gould, Pour une science de la biographie, p. 48 sq),j'en suis pleinement d'accord. La question n'est plus la même quandl'ambition du connaître vise des êtres d'activité : les débats de notre vie, lesrenormalisations, confrontés à un ici et maintenant jamais standards, sontpour partie inanticipables et en appellent à des rectifications inassignables« Si nous étions sur le mode de l'être naturel, notre irrécusable détermination par lemonde humain serait exclusive de toute vraie spontanéité en nous. Mais nous sommessur le mode de l'agir historique ». De manière très variable, « nous coopérons à notredétermination historico-sociale, nous en venons ainsi à déterminer nous-mêmes dequelles façons nous serons déterminés ». (L'Homme, p.484). Mais qu'est-ce « être sur lemode de l'agir historique » ?Par rapport à l'inscription dans le symbolique (de la psychanalyse), L.Sèveinsiste très profondément dans l'Homme sur « l'inscription dansl'axiologique » : au sens où la personnalité peuplée d'autrui forme sadynamique singulière en valorisant /dévaluant à sa façon les valorisations detous ordres que lui propose ou impose son univers » (p.486). Cette phrase quiest comme en parallèle à la dynamique canguilhémienne de la polarisation envaleur de notre milieu, nous la ferions entièrement nôtre. Mais quel lien decette inscription avec les dramatiques de l'activité ?Là encore nous sommes renvoyés à l'activité dans ses œuvres. On vient deparler de savoirs-valeurs : toute renormalisation suppose des savoirs maiselle s'en outille pour trancher dans ses « valorisations du milieu ». Pas d'agirsocial sans prise d'un « monde de valeurs » sur l'agir humain, mais du mêmecoup sans retravail de ce monde axiologique parce que l'expérience desrenormalisations sédimentée en nous redessine sans cesse pour nousl'architecture de ce monde.Tout agir humain est donc localement retravail, redéclinaison de valeurs devie humaine, entre un pôle à dimension universelle, et un pôle adhérent à l'ici-maintenant d'un être singulier. Tout agir porte avec lui des « réservesd'alternatives », mais inanticipables, exigeant une instruction par les débatsde normes locaux pour accéder à l'existence. Potentiellement, bienpolitiquement précieux, mais sous réserve de mise en visibilité, de mise endébat, pour être transformé le cas échéant en force sociale, en viséeémancipatrice.7- Essence humaine ou monde social à construire ?Dans la mesure où l'activité est non pas médiatrice (entre la personnalité etl'essence humaine excentrée), mais (re-) productrice, jour après jour, decette essence, celle-ci est en construction permanente en divers lieux etcirconstances de la planète homme. Elle ne peut être « préalable à l'existencede chaque individu particulier », qui la reproduirait sous une forme« contradictoire, morcelée, incomplète » (MTP, p.170). Elle resteprofondément indéterminée ; et cela rend difficile à comprendre comment « laloi de la production moderne < la > rendra intégrale » (ibid), ou commentpenser le ressaisissement, la désaliénation, pour reprendre les termes plusrécents de « L'Urgence du Communisme » (2012). Oui, l'agir humain ne peutvaloriser positivement en termes de santé un champ d'épreuve où les normesantécédentes quantitatives et financières cherchent à préempter ses débatsde normes. Mais comment de là anticiper une réappropriation salutaire parles producteurs associés des potentialités d'un nouvel usinage de la viesociale ? « Faire de chacun et tous les maitres directs de leurs puissancessociales » (Aliénation, p.68) ? Sans doute, L.S évite le tout - les ingrédients de laréappropriation seraient déjà présents, son actualisation ne serait qu'une affaire de « lutte de classes psychologique » (si je puis dire)-, ourien (seul un monde débarrassé de l'appropriation capitaliste peut mettre un terme au clivage entre motifs internes et buts externes de l'agir). Il développe bien dansAliénation, p.68 sq, et p.76-77 les « présupposés » (Marx), « les possibles novateurs » présentsdans l'actuel préfigurant une société désaliénée. Ce serait à discuter, maisces présupposés se moulent dans des formes revendicatives dont l'issueparaît déjà claire et partagée (ibid.p.86), sans qu'il soit nécessaire de mettreen visibilité les « réserves d'alternatives », les valeurs-savoirs de l'activité. Ilsfont l'hypothèse d'une homogénéité d'objectifs dans la lutte réappropriative,alors que la « trituration » du monde du travail a terriblement fragmenté,diversifié, distancié les « dramatiques d'usage de soi » de l'agir industrieux.Si subsistent et grandissent les écarts de puissance et de pouvoir de vivreentre les individus de la planète, sur quelle base néanmoins opposer lesclasses4 à l'époque d'un « capitalisme monopoliste mondialisé, informatisé etnumérisé », comme dit mon ami marseillais P.Assante, auteur d'un blogdébordant de richesse 5 . Est-ce si évident de distinguer par anticipation« l'accumulation de moyens sociaux en dehors des producteurs », ce qui estnormal, et « leur confiscation par une classe étrangère, positionnellementhostile à leurs intérêts vitaux » (L'Homme, p.505) ? Est-ce si évident deconstruire « l'appropriation associative des puissances sociales aliénées »(L'Aliénation,p.86 et 83) et par exemple la prise en main d'une entreprisecondamnée à une mort boursière (ibid) sans s'instruire des réservesd'alternatives mais aussi des réserves de difficultés, de divisions à dépasserque les entités collectives de l'agir industrieux, fragiles, et jamais données apriori, peuvent permettre d'anticiper. Gérer une entreprise à partir desproducteurs de sa valeur ajoutée : axe majeur de l'émancipation aujourd'hui.Mais imagine-t-on que l'on pourra consensuellement générer une visionstratégique, une gestion des compétences, des organisations, desrétributions sans s'instruire et mettre en débat les réserves d'alternatives enpénombre des protagonistes ?L'essence humaine n'est ni donnée, ni anticipable, par des dynamiquessimples. On ne peut sauter par dessus ces complexes de savoirs-valeurs quegénèrent les réserves d'alternatives de tout agir humain. C'est aussi unequestion que l'on pourrait poser aux belles thèses de Dardot et Laval sur « Lecommun »6. A propos du geste ouvrier, nous disions il y a longtemps qu'ilfallait inscrire l'agir dans un continuum qui tient d'un côté de la différentielledu geste élémentaire et de l'autre de l'intégrale des rapports sociaux 7 .Donner visibilité à ce continuum, c'est s'inscrire dans une posture « DispositifDynamique à trois pôles », évoqué plus haut, dont le troisième s'appelleprécisément, avec toute l'indétermination associée, « pôle du mondecommun à construire ».*Comment cette anthropologie de l'activité peut nous aider à penser la naturedes contradictions et inspirer l'agir politique ?On vient de prendre quelques distances avec L.Sève. Pourtant deux pointsnous font revenir sur ses thèses et leurs conséquences sur la militancepolitique.Le premier point : les rapports entre l'activité et l'argent. La subversionactuelle, dit-il, est que « la fin est asservie au moyen, et donc l'humain àl'argent » (ibid, p.81). « Et s'il est une chose que personne n'a vu travailler,c'est l'argent, n'étant lui-même autre chose en dernière analyse qu'uneexpression abstraite du travail » (ibid, p.88). Pour des raisons qui tiennentpour nous à la nature de l'activité, nous rejoignons son diagnostic selonlequel c'est la circulation dont le moteur est la valeur d'échange, A-M-A', quitendanciellement a chance de faire crise de la personnalité.Si toute activité est enchainement de débats de normes, ceux-ci sonttranchés par des complexes de savoirs-valeurs dont cette forme valeur nepeut-être - au moins exclusivement- monétaire. Au cœur de la productionmarchande du système capitaliste, une disposition non marchande résisteabsolument à sa réduction financière.De ce fait, faire droit au continuum, que fonde cette disposition, entre ladifférentielle du geste élémentaire, où se reproduit jour après jour cetterésistance et l'intégrale des rapports sociaux où cette résistance demande à« faire monde », c'est dire que l'ouvraison « ergologique » pluricentrique del'essence humaine suppose une dialectique militante entre les niveaux microet macro de la vie sociale.Quelles stratégies pour lutter contre cette sorte de « dérive des continents »qui tend à invisibiliser le rapport entre la comptabilité en argent et lesdramatiques de l'agir qui pourtant la supportent ?Point clé d'une politique de l'activité, sur lequel j'ai récemment écrit,notamment dans un texte que le Centre G.Péri, qui me l'avait demandé enNovembre 2014 n'a finalement pas publié -il l'a mis sur son site- et dont uneversion allégée va, semble-t-il, paraître dans Actuel Marx .Le second point : cette recherche de mesures mobilisatrices appelées parmon approche de l'activité humaine m'a reconduit au Chapitre 6, « Ladialectique matérialiste » de Une Introduction à la Philosophie Marxiste(Editions Sociales, 1980). A ce jour, sa distinction entre contradictionantagonique et non antagonique me paraît être le point de vue le plussynthétique, le plus stimulant, pour éclairer la mise en œuvre de cettepolitique de l'activité. Je le dis brièvement en mon langage « ergologique » :En tant qu'êtres d'activité aptes à produire divers types de savoirs, nousn'échapperons pas aux contradictions entre normes antécédentes et normesrecentrées, entre anticipations des situations de vie par des concepts « endésadhérence » et anticipations des renormalisations par des savoirs enprise sur l'ici et maintenant, entre savoirs disciplinaires et savoirs valeurs,entre organigrammes et « entités collectives relativement pertinentes »,entre « risques professionnels » et « risques du travail » (pour évoquer lechamp de la prévention industrieuse, voir Schwartz 2015 c) ...et finalemententre usage de soi par les autres et usage de soi par soi. Autant de formes decontradictions anthropologiques, inéluctables et fécondes, matrices de toutehistoire. Mais toutes dans notre monde actuel, surdéterminées par unecontradiction antagonique, lieux d'usurpation et d'occultation, propres àmaintenir le moteur de l'inégale distribution des ambitions à vivre. Commentalors assumer et gérer ces contradictions non antagoniques, tout en luttantsimultanément contre leur subsomption, leur empiètement parl'antagonique ?Merci, Lucien, de m'avoir fourni cette clé multiusages, clarifiant mesengagements militants.*Il y a quinze jours, à ...cent mètres d'ici, était rendu hommage à Alain Wisner,en son lieu magique du 41 rue Gay-Lussac, où il avait exercé face à desgénérations d'ergonomes et de militants son magistère atypique. Aujourd'huiil nous est donné d'honorer un philosophe, un militant, un homme d'unestature exceptionnelle. Mais cette fois-ci, c'est en un lieu où lui fut refusédurant des décennies ce statut qui pourtant nous grandit tous. Merci à ceuxqui ont mis fin à une trop longue attente, et merci à Lucien d'avoir patientéavec tant d'équanimité pour une réparation que ses convictions et sa justeappréciation des choses n'ont jamais conduit à réclamer.**BIBLIOGRAPHIE ADDITIONNELLEOddone, I et alii. 1981, Redécouvrir l'expérience ouvrière, Editions Sociales.Schwartz, Y 2000, Le Paradigme Ergologique ou un métier de Philosophe, OctarèsEditions Toulouse2001, Philosophie et Ergologie , Conférence à la Société Française de Philosophie, Vrin, Paris.2007, « Brève histoire culturelle du concept d'activité », Revue Activité Vol 4, n° 2, pp 122-133.2015 (a), « Vygotski/Spinoza », Revue philosophique de la France et de l'étranger 2015/4 (Tome 140), p. 561-566.2015 (b), « Où se trouvent les réserves d'alternatives ? Travail et 'Projets - Héritages' », sur le site site : http://www.gabrielperi.fr/1542.html , 2015.2015 (c), « L'énigme du travail : risques professionnels et risques du travail », inLes Risques du Travail, Thébaud-Mony A, Davezies P, Vogel L, Volkoff S sous direction, La Découverte.Sève, L 1975 (1969), Marxisme et Théorie de la Personnalité, 4ème édition, EditionSociales.1980, Une Introduction à la philosophie marxiste, Editions Sociales.Pas forcément simple, voir par exemple à propos de la formation professionnelle dansnotre Le Paradigme Ergologique ou un Métier de Philosophe, p.369-373.2008, Penser avec Marx aujourd'hui, t II, L'Homme, La Dispute.2012, Aliénation et émancipation, précédé de « Urgence du communisme »,suivi de « Karl Marx : 82 textes du Capital sur l'aliénation », La Dispute.2015, Pour une science de la biographie, suivi de « Formes historiques del'individualité », Éditions Sociales.**